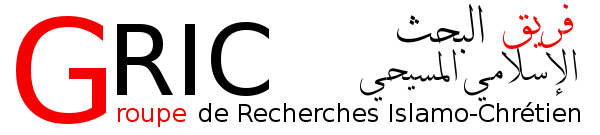La perception des espaces sacrés, leur fonction symbolique, restent un motif important de la tradition mystique musulmane. Celle-ci est tellement variée qu’il est difficile de trouver un discours unifié sur la perception de l’espace, de sa sacralité, et la symbolique des rites qui lui sont relatifs. Mais l’on peut toujours, à travers cette longue et riche tradition, évoquer quelques traits communs.
La hiérarchisation de l’espace et les rites religieux sont considérés comme réels par les mystiques, et ils sont en tant que tels admis comme relevant de la Šarī‘ah, la Loi religieuse. Ils sont respectés et observés scrupuleusement. Mais l’essence de la mystique établissant un rapport privilégié et exclusif à l’Être absolu, ces rites de la Šarī‘ah n’atteignent la plénitude de leur sens qu’en retrouvant leur dimension spirituelle profonde. Les mystiques peuvent ajouter leur espace parallèle propre. Lorsque le mystique cherche à parfaire son accomplissement en communauté, c’est l’organisation de la confrérie qui dispose souvent d’un lieu propre, la zaouïa. Souvent, c’est l’isolement individuel ; on choisit alors un lieu éloigné de l’espace collectif. À certains grands mystiques, fondateurs de confrérie, on consacre un ou plusieurs lieux qui deviennent des lieux de pèlerinage. Ces lieux, qui se situent dans une sorte d’extraterritorialité, se sont trouvés souvent soustraits à l’autorité publique, et ont offert de ce fait un refuge à ceux qui étaient victimes d’une adversité politique ou autre.
Certaines figures mystiques, comme Ḥallāǧ, sont tellement emportées par leur passion pour Dieu, qu’elles ne cherchent pas moins que l’union avec Lui. La sacralité des lieux continue toujours à être significative, mais on cherche alors à investir la topographie religieuse ordinaire d’une signification ésotérique, intérieure. C’est une sorte de fiqh bāṭin, une jurisprudence de l’intériorité parallèle à la jurisprudence extérieure propre aux fuqahā’’ (Docteurs de la Loi), qui régit publiquement le comportement dans un lieu sacré. Les soufis peuvent continuer à errer de par le monde et continuer leur quête d’un accomplissement spirituel, et la pérégrination géographique continue à réaliser un apport très riche. Pour d’autres maîtres, comme Bisṭāmī, cette quête ne porte plus sur les choses extérieures, elle porte sur le moi profond, et la réalisation et l’accomplissement sont à chercher en notre for intérieur. Les lieux physiques tendant à devenir égaux, il n’y a plus besoin de ces pérégrinations physiques : la voie vers Dieu est intérieure. On raconte que, dans sa mystique de l’union avec Dieu (ittiḥād), Ḥallāǧ avait fabriqué chez lui un modèle de la Ka‘bah pour y reproduire les rites du pèlerinage.
Pour d’autres courants mystiques, comme celui de l’unicité de l’être (waḥdat al-wuǧūd) de la tendance d’Ibn ‘Arabī et d’Ibn Fārid, Dieu se manifeste continuellement et sans exception dans tous les êtres, la fréquentation des lieux sacrés continue toujours à faire vivre des moments de grande intensité, et la hiérarchisation de l’espace demeure une source d’inspiration (le fameux poème d’Ibn ‘Arabī sur la Ka‘bah, dans son livre des Futūḥāt). Mais cela oriente essentiellement vers des mystères illimités qui restent à dévoiler. La sacralité d’un espace n’est plus exclusive. Dans une vision où Dieu se manifeste dans tous les êtres, sans exclusivité, aucune personne, aucun endroit n’a plus le monopole du sacré. Tous les êtres sont bénis, étant des manifestations égales de l’Être Unique. Le cœur du gnostique devient un réceptacle universel. Dans ce courant mystique, l’unité de l’être reste relative. Dans l’autre courant, comme celui d’Ibn Sab‘īn, qui prône l’unité absolue de tout l’être, toute distinction d’une entité, qu’elle soit un lieu ou une personne, est pure illusion. C’est le solipsisme divin absolu.