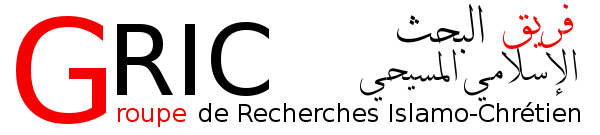Cet article fait partie du dossier de recherche du GRIC intitulé : « Espaces sacrés, lieux de violence ou lieux de paix ? »
Exister, subsister et prendre conscience de soi est, pour la communauté religieuse, lié à sa capacité de se forger une mémoire collective. Celle-ci assure à la communauté la transmission de son capital culturel et la dote de la faculté de remonter le cours des temps et de repasser sur les traces qu’elle a laissées d’elle-même.
1. La mémoire collective : caractéristiques et rapport à l’espace
Deux caractéristiques spécifient la mémoire collective :
La première est son rapport à la mémoire individuelle : la mémoire collective n’est pas la mémoire individuelle, bien qu’elle l’implique à des degrés divers. Pour la mémoire collective, il ne s’agit pas seulement de se souvenir, mais de se retrouver avec un « nous » : « Si autrui est nécessaire pour se rappeler, ce n’est pas parce que moi et autrui nous plongeons dans la même pensée sociale, c’est parce que nos souvenirs personnels sont articulés sur les souvenirs des autres personnes, dans un jeu bien réglé d’images réciproques et complémentaires. Le groupe ne conserve que la structure des connexions entre les diverses mémoires individuelles »[1].
La seconde, c’est son rapport au passé, qui se différencie de la narration historique. Celle-ci est le fruit d’une opération intellectuelle d’enquête et d’écriture de l’histoire, à partir d’une reconstruction de ce qui n’est plus et, de ce fait, elle est inassimilable au croisement de mémoire qui définit la mémoire collective. Donc, c’est moins sur les usages institutionnels du passé que sur les représentations de ce passé, telles que le groupe les a conservées et réinventées, que la mémoire collective se focalise ; d’où l’importance de la position que symboles, préceptes et normes y occupent. La mémoire collective ne fonctionne pas dans le vide : elle a ses repères qui s’inscrivent dans des récits, des objets et des lieux. Dans les lieux campe le « nous » de la résistance culturelle. Même si ce « nous » est sans cesse retravaillé, il reflète la volonté de se perpétuer. Ainsi se trouve posée la question de la continuité de la communauté et les rapports qu’elle entretient avec ces lieux. Selon M. Halbwacks, l’espace social donne des lieux au devenir, le focalise dans la conscience d’un vécu commun et d’une appartenance collective : « C’est l’image seule de l’espace qui, en raison de sa stabilité, nous donne l’illusion de ne pas changer à travers le temps… L’espace seul est assez stable pour pouvoir durer sans vieillir ni perdre aucune de ses parties »[2]. Donc, si toute mémoire collective a son lieu d’élection, le lieu d’élection de la mémoire religieuse est le lieu saint.
2. Lieu saint et mémoire religieuse
Pour la mémoire religieuse, le lieu saint est un lieu qui incarne un acte fondateur : il rend compte de l’origine du monde et de la communauté : La Ka‘bah pour les musulmans, le mont Sion pour les juifs, sont le nombril de la terre. Dieu a créé le monde par le nombril et, de là, il s’est répandu dans toutes les directions, ainsi que pour le premier homme façonné dans ce même lieu. Dans le Nouveau Testament, l’espace sacré a son sommet dans le Christ, qui est le nouveau Temple. Mais est-ce à dire qu’il n’y a pas de lieux saints pour les disciples de celui qui incitait à rendre un culte « en esprit et en vérité » ? En fait, certains lieux rappellent les événements fondamentaux de l’histoire du salut chrétien. En effet, avec l’ordre donné, au IVe siècle, par Constantin de rechercher les vestiges de la Crucifixion et de la Résurrection, sa venue par la suite à Jérusalem et son inauguration de la Basilique du Saint Sépulcre, on assiste à une véritable résurgence chrétienne de Jérusalem, ville sainte et lieu d’origine de la tradition chrétienne.
Donc, plus qu’un lieu de culte, le lieu saint est le cadre de référence qui dit la mémoire « vraie » de la communauté ; il rappelle sans cesse que l’essentiel, qui donne sens au présent et qui contient l’avenir, est derrière. C’est par les rites que la communauté inscrit, dans le déroulement du temps et de la vie de chacun des croyants, la mémoire des événements fondateurs. Symbole d’une origine commune, le lieu saint alimente l’imaginaire de continuité : le croyant se considère comme engendré, donc membre d’une lignée qui rassemble les croyants du passé, ceux du présent et ceux du futur. Cette filiation implique la référence aux souvenirs que le croyant partage avec les membres de sa communauté, en se sentant responsable de les transmettre ; d’où le rapport étroit entre filiation et tradition religieuse.
L’importance de cette tradition ne se résume pas à l’acte de transmission d’un patrimoine, qui assure la continuité de la communauté, mais elle lui attribue surtout un sentiment de profondeur, qui se présente sous forme de fidélité à ce qui fut événement fondateur, dont le présent révolu est toujours à réactiver contre l’oubli et la dégradation. Toutefois, cela n’exclut en aucun cas le processus de relecture, qui est processus de création d’un rapport renouvelé au passé, en fonction des données du présent. En dehors de cette continuité et de cette profondeur, l’identité collective, pas plus que l’identité individuelle, ne peut s’élaborer. Dans cette perspective, le lieu saint, que l’imaginaire investit d’une aura symbolique, concrétise aux yeux de la communauté l’identité et les liens solides d’appartenance, nécessaires à la projection dans le futur. En effet, toute projection dans le futur suppose l’anticipation d’une continuité et l’affirmation d’un ordre maintenu en profondeur, sous la surface d’un changement incessant. Affirmer l’avenir, c’est retrouver un principe d’existence dans l’histoire.
3. Mémoire religieuse, filiation et identité
Dans ce qui précède, on a souligné le lien étroit entre identité et mémoire : il ne peut y avoir d’identité sans mémoire. En dehors de cette faculté, l’individu perd la conscience de soi et se trouve « enlisé dans l’instant, dans un moment vide de sens, sans passé ni avenir » [3]. Il en est de même pour toute communauté, en l’occurrence la communauté religieuse : la mémoire religieuse y entreprend un travail unificateur qui fonde l’idée de continuité et de filiation.
Pour le musulman, descendre en droite ligne du prophète Ibrahim, avoir reçu du prophète Muhammad son identité religieuse et avoir préservé la langue de la révélation, sont autant de références à un passé fondateur. Ces références servent aussi l’objectif présent et futur de rester unis et d’appuyer sur une histoire immémoriale une identité éternelle.
Même s’il arrive, pour diverses raisons, que la communauté se transforme ou se désintègre, le sentiment de partager les mêmes ancêtres persiste ; la prière de Jean-Paul II devant le Mur des Lamentations, lors de sa visite à Jérusalem à l’occasion du grand Jubilé de l’an 2000, en est un exemple. Sa « Lettre sur le pèlerinage aux lieux qui sont liés à l’histoire du Salut » le formule clairement : « Le point de départ sera quelques-uns des lieux typiques de l’Ancien Testament. Je désire de cette manière exprimer la conscience qu’a l’Église de son lien inséparable avec l’ancien peuple de l’Alliance. Abraham est aussi pour nous, par antonomase, le père dans la foi … C’est justement à Abraham qu’est liée la première étape du voyage… Je voudrais au moins, s’il plaît à Dieu, m’arrêter à Ur, lieu d’origine d’Abraham, puis faire une étape au célèbre monastère Sainte Catherine, au Sinaï, près du mont de l’Alliance, qui contient en quelque sorte tout le mystère de l’Exode, paradigme perpétuel du nouvel Exode qui se réalisera sur le Golgotha… »[4].
- [1]R. BASTIDE, « Mémoire collective et sociologie du bricolage », in : L’Année sociologique (1970) 65-108↩
- [2]M. HALBWACKS, La mémoire collective (Paris : P.U.F., 1968)↩
- [3]T. TODOROV, « La mémoire devant l’histoire », in : Terrain (sept. 1995), p. 112↩
- [4]Lettre sur le pèlerinage aux lieux qui sont liés à l’histoire du Salut, datée du 29 juin 1999↩