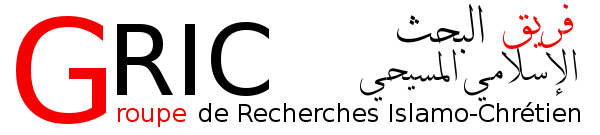Sommaire du dossier : Le couple/mariage islamo-chrétien
- Dossier GRIC International : « Mariage islamo-chrétien » – Présentation
- Textes en exergues de pasteurs
- Regards croisés : Point de vue d’un chrétien
- Regards croisés : Point de vue d’un musulman
- Abstracts
- Identité chrétienne dans le mariage dispar
- L’interdiction du mariage de la musulmane avec le non-musulman
- Le couple mixte installé au Maghreb
Farid el Asri,professeur-associé à l’UIR et membre du GRIC-Maroc
Le mariage islamo-chrétien au Maghreb : entre contraintes et espérances
Le mariage religieusement mixte ouvre une boite de pandore qui laisse se déployer un kaléidoscope fait, aussi bien d’aspects alambiqués de société, que de vécus projetant espérances et épanouissements. L’objet du présent dossier jette ainsi un pavé salutaire dans la mare et permet d’analyser, in situ, des expériences d’unions maritales liée à des praxis sociales particulières, tout en nous montrant que les collisions de l’instant peuvent être progressivement dépassées dans le temps. Le mérite du travail consiste donc à nous éclairer à grands feux sur l’angle mort d’unions islamo-chrétiennes, sises principalement sur la rive Sud de la Méditerranée, et dévoiler dans le même temps des accommodements raisonnables qui font la réussite de transitions et de rapprochements possibles. Ainsi que le mettent en évidence les contributions de Nadia Ghrab-Morcos et les réflexions présentées par Anne Balenghien à Barcelone et qui questionnent positivement l’environnement social, les communautés d’ancrages et l’institutionnel religieux. Ce mariage en dit tout autant sur nos sociétés en mouvement, à partir des perceptions de l’altérité, des relations à l’autre religion et sur les équilibrismes socio familiaux. Cette forme de mariage reste donc un indicateur des coefficients des libertés en cours (individuelles, de consciences…) et met en perspective un interactionnisme complexe avec l’institution sociale qu’est la famille musulmane élargie. Dès lors, cette union particulière nous renseigne, de fait, sur des pratiques socioculturelles et religieuses, des crispations individuelles et collectives, sur des configurations sociales où tourne la courroie de transmission identitaire du groupe et sur les issues possibles d’un devenir commun ; par la fabrication de modalités relationnelles optimistes et pratiques.
Des trajectoires riches se lisent dans les narrations et qui témoignent de l’intérieur d’un univers où peut mariner un conservatisme socioreligieux et culturel tenace mais où les rigidités ne sont pas définitives. Certains articles montrent à quel point des souplesses, voire des co-inclusions s’opèrent dans le temps et que ce dernier est un élément essentiel pour comprendre la mise en perspective des phénomènes soulevés[1].
Les points de départs ne sont pourtant pas faciles, car si nous sommes sortis des conceptions géographiques figées, paradoxalement, nous demeurons tributaires, au cœur de sociétés musulmanes globalisées, d’une saillance des frontières entre islam et chrétienté. Nous nous confrontons donc aux limites de la géographie de la croyance et aux recompositions individuelles et collectives dans les aléas de la postmodernité. Et si les constructions de foyers mixtes symbolisent des ponts entre les rives, elles permettent tout autant de faire émerger quelques inconforts du temps présent face à la différence. Mais cette problématique de la gestion de la mixité peut se lire avec beaucoup de similitude dans le contexte européen par exemple. Même si certains ressorts restent circonstanciés à chaque environnement : retenons, pour le Maghreb, les casuistiques juridiques et normatives, ainsi que les aléas socioreligieux de sociétés musulmanes. La mise en perspective de cette forme de mariage illustre, entre-autres, des projections de transitions biographiques. Il importe donc d’avoir une lecture élargie des mariages religieusement mixtes pour ne pas essentialiser un moment d’analyse à l’ensemble de l’expérience de mixité. Les trajectoires sont plurielles et se mesurent, à partir d’une sociologie des quotidiens, en fonction de circonstances, de générations, de pays d’ancrages ou de moments précis dans le vécu.
La particularité de l’ancrage de ce type d’union dans le contexte musulman nécessite également de prendre en compte tout l’environnement socioreligieux macro, car il pèse de tout son poids symbolique et effectif dans le débat. Le(s) monde(s) musulman(s) hérite(nt), depuis les interrogations de Chakib Arsalan (m. en 1946) ou de Malek Bennabi (m. en 1973), d’une mise en abime significative et perpétuelle d’un soi qui tente de se retrouver. Le réflexe général est que, frappé par des fragilités identitaires profondes, l’islam se recroqueville pour s’illusionner de la protection et de la préservation utopique d’une identité intouchable, inébranlable. Une identité figée, se gargarisant de résister aux couches de l’histoire et aux flux socioanthropologiques, est un doux leurre qui cache bien des douleurs. Le défi que l’autre pose dans le corps social de l’islam traduit dès lors des résistances radicales pour: la préservation des traditions et des cultures, des ancrages religieux et familiaux, des patrimoines de misogynie ou de rapports à la femme, à la liberté et au christianisme. Avec les remous d’histoires profondes et douloureuses, et notamment les relations belliqueuses entre islam et chrétienté, ou l’expérience du colonialisme encore vivace dans les esprits ; les rapports du moment sont loin d’être déchargés des lourdeurs mémorielles au sein du corps social. La psyché collective n’entretient donc pas de rapport virginal avec l’autre et on peut vite devenir l’ex-colon privilégié de service ou la croisée en terre d’islam. Ces perceptions, qui conditionnement le regard sur l’altérité, peuvent être réciproquement entretenues dans les imaginaires. Et si certains penchent pour la promotion d’un dialogue renouvelé par la rencontre, d’autres, par exemple, pensent le comment rendre la chrétienne soluble dans le Maghreb voire le musulman dans la laïcité (pour le climat le français par exemple). Rajoutez à tout ceci un climat à fleur-de-peau par rapport au dit prosélytisme actif, ou même une méfiance vis-à-vis d’un « prosélytisme passif » (par le simple fait d’être là et d’être soi) et vous aurez reconstitué un des aspects de vie avec lequel nos minorités religieuses doivent parfois être confrontées dans nos sociétés. C’est donc l’ensemble de la mécanique identitaire et socioreligieuse qui peut être transversalement grippée et que le couple mixte risque, selon les cas, de se prendre de plein fouet. Fondamentalement, ledit mariage est (in)consciemment rendu coupable de fragiliser le mythe de l’homogénéité socioculturelle et le confort d’un héritage religieux communément partagé. L’union maritale entre christianisme et islam consiste ainsi en une fine transgression des barricades de paradigmes socioreligieux et sort les communautés de l’illusion des hermétismes. La mixité réconcilie donc une majorité avec la prise de conscience qu’une transformation n’est pas une déformation, et qui ne veut pas dire non plus abandon de soi mais bien inclusion en soi. Il s’agit par-là de faire le cumul des expériences qui font la richesse des nations. Et si le sens du débat reste encore souvent une mise en tension entre le cœur et le ciel, il nous semble qu’il tourne surtout dans une mise en friction entre le soi et soi. L’altérité religieuse peut réussir de permettre à terme un face-à-face fait de retrouvailles et de réconciliations identitaires réciproques.
Sur une échelle plus resserrée, le mariage religieusement mixte, tel que vécu au sein des sociétés musulmanes contemporaines, met en saillance des contours inattendus d’une expérience de l’altérité religieuse. Cette microsociologie du couple permet le déploiement d’une analyse des constructions familiales où se situe l’enjeu du comment faire corps à partir de la diversité. Voilà une mise en couple développée hors des limes de la géographie religieuse et des frontières ethnoculturelles et qui questionne la société. Elle est soupçonnée d’éveiller des appréhensions collectives, du fait des turbulences qu’elle est supposée faire peser sur les équilibres sociaux. Ces unions restent génériquement perçues par leur non-conformité à l’environnement, celui d’un entre soi confortable et conjoncturellement traversé par la confusion des genres. Les « outsiders amoureux » se trouvent dès lors contraints, pour persévérer dans le mariage, d’engager leur choix dans un tumulte de codes patriarcaux et dans des cultures conservatrices en résistance. S’engager dans cette voie équivaut donc à résister à deux ou individuellement contre un écosystème d’imaginaires, de normes et d’us relationnelles et déployer une créativité afin de bâtir des rapports dans le dépassement des contraintes et dans une reconnaissance progressive. L’environnement parfois hostile résiste à son tour en faisant collectivement corps à la différence dite intrusive, avant de donner un visage humain à cet autre qui a mentalement été construit par la mise à distance. Le couple promis pour le meilleur se confronte ainsi au pire alors qu’il est accusé, dès l’annonce des noces, d’endiguer au cœur, autant l’ordre social des familles que le prolongement d’un soi serein à l’identité homogène. Les compositions assumées par le couple sont même parfois soumises à la révision du groupe et notamment en début de mariage. Cette intrusion collective n’est justifiée que parce que le couple engage un dérèglement du confort social et que son choix problématique, qui s’impose désormais à tous, ne lui appartient plus vraiment. La préservation du ciment identitaire du collectif permet un certain nombre d’autorisations et d’interférences dans l’intime : la conversion ou l’arabisation du prénom de la mariée chrétienne, l’incompréhension de la « résistance » de l’hôte à entrer, malgré l’hospitalité collective et prédicative, dans l’islam et les encouragements continus ou les violences symboliques qui s’en suivent, voire le parasitage dans l’éducation des enfants ou, du moins, dans l’affirmation tranchée pour un choix religieux exclusif.
Jugé à ses débuts par le sentimentalisme puéril, la témérité têtue, la fragilisation ou l’offense des pairs, l’organisation de ce type de conjugalité se construit pour certains commencements dans le pas-de-côté et dans le contre-pied systématique. Ce débat aux arrière-fonds identitaires fabrique le réflexe du rejet. Il peut être sulfureux, passionné et puiser son argumentaire, pour justifier le choix de barricades identitaires, dans une herméneutique religieuse culturellement conditionnée. Les choses ne se passent pas toujours au travers de ce prisme, mais des ressentiments sont quelque fois suivis de radicales tentatives de remises du binôme « transgresseur/étrangère» dans l’ordre établi. Ceci passe entre-autre par la pression psychologique et le chantage affectif. Le sursaut de mères en transe émotionnelle, en pleurs, et qui supplient, voire ordonnent au fils zélé de ne pas céder à la sirène de l’étranger, et ce parfois jusqu’au jour de la fête, pèse sur le futur du relationnel micro-familial. Il en dit surtout beaucoup sur les conditionnements des rapports et des perceptions réciproques sur le long-terme. Ce démonstratif émotionnel maghrébin, s’il est souvent un baroud d’honneur inefficace, reste surtout un indicateur de risque de déstabilisation indéterminée des rapports sociaux avec le couple et peut retarder la mise en place d’un processus d’intégration mutuelle et de reconfiguration de l’unité familiale par la complexification de ses provenances. Le mariage religieusement mixte peut aussi se révéler un véritable défi, car on peut être accablé autant dans son choix que dans les impacts culturels que la réalisation suppose. Soit on opte donc pour l’amour individuellement et librement choisi, soit on préfère la sérénité des siens, choisissant dès lors un modèle d’union monochrome et qui prolonge un « soi maitrisé » sur le futur. Beaucoup penchent aussi pour ne pas devoir choisir dans la binarité et amorcent, de fait, par l’expression d’un double-choix, un changement social lent, infime mais symboliquement significatif. On aura compris que, dans ces circonstances, le maintien de la barre peut dans certains cas s’avérer psychologiquement éprouvant pour le couple. Une atmosphère sociale à gérer peut soit s’orienter vers une fragilisation de la relation des conjoints, saturés par trop de tensions, soit faire du particularisme un atout et une distinction positive en vue de promouvoir, de fait, une réalité maritale et familiale réussie. Une typologie des profils peut donc nous ouvrir sur un faisceau d’expériences très contrastées et qui nous disent la richesse de trajectoires. Ces profils variés servent aussi de tensiomètre de sociétés qui sont de fait orientées vers un assouplissement à la base et où s’accélère une sorte d’entre-connaissance au quotidien.
Une fois réuni autour du berceau, on retrouve des questionnements de fonds sur les devenirs et le choix des enfants, mais aussi une ouverture sur des problématiques nouvelles. La question de l’héritage de conscience, en plus de l’héritage matériel, en fait principalement partie. Le point de la filiation religieuse, conditionnée par un héritage patriarcal, où le cadre juridique détermine la question des legs, compte parmi les points sensibles qui caractérisent les contextes familiaux et le devenir des enfants[2]. Ces références s’appuient généralement sur un arrière-fond religieux. Là où on met en avant le référentiel canonico-normatif de l’islam pour fonder les avis, les lois et les argumentaires réfractaires au mariage religieusement mixte et toutes les difficultés qui peuvent en découlent, à l’instar de ce que développe Jeanne Ladjili pour la tradition chrétienne[3]. Notons que même s’il n’est pas interdit de se marier avec une femme dite des « Gens du Livre », on retrouvera pléthore de textes et d’avis juridiques de fuqahâ’ pour avantager en priorité le mariage avec la musulmane et ainsi décourager toute autre option. L’abus dudit « principe de précaution » dans le fiqh et l’interférence avec une théologie piétiste ambiante et une orthopraxie exclusive fondent ce type de posture. Et si une sorte de consensus semble s’ériger pour interdire radicalement le mariage d’un non-musulman avec une musulmane (cf. les expériences et analyses développées par Amel Grami ou Asma Nouira dans le présent dossier[4]), un questionnement de fond s’invite pourtant pour (ré)interroger cette évidence. Une sociologie d’une présence musulmane démographiquement minoritaire en contexte européen déborde déjà sur cette rigidité non-négociable.
Le mariage religieusement mixte se révèle en fin de compte être un indicateur essentiel quant à l’urgence de développer une réflexivité historico-critique sur un patrimoine interprétatif de la norme et de la morale religieuse. Mais il en appelle aussi à une herméneutique coranique fondamentale faisant face au défi de son universalité et en dialectique avec les réalités et enjeux contemporains. Cette lecture est une réconciliation avec le sens, en vue de dépasser les conditionnements induits par les environnements sociaux. C’est même une réconciliation qui permet d’éviter le recours à des parades telles que les conversions administratives, par une logique de contournements des contraintes ou des freins juridiques. Mais cela permet finalement de redonner sens au dialogue et aux apaisements identitaires par la confiance en soi. Ce type de mariage mobilise des possibles : une humanité nourrie d’universalité et décloisonnée des exclusivismes communautaires. Plus qu’une théologie de la libération, c’est à une théologie de la liberté que ces expériences de vies nous invitent et que ce dossier met pertinemment bien en évidence au travers des analyses pertinentes et des témoignages forts.
[1] Cf. Nadia Ghrab-Morcos, « Vivre ensemble : une attitude intérieure, un chemin pour grandir », GRIC Tunis, 2011 et Anne Balenghien, « Par-delà l’expérience et le(s) vécu(s) des couples dits ‘islamo-chrétiens’, quelques réflexions et interpellations qui s’adressent à notre société, nos communautés et institutions religieuses », Barcelone, 27 février 2015.
[2] Le couple mixte au Maghreb, une situation révélatrice ? Anne Balenghien, Mohammed Benjelloun-Touimi, Anne-Marie Teeuwissen, Sabine Wollbrecht, 2001-2003.
[3] Identité chrétienne vécue dans le mariage dispar, Jeanne Ladjili, décembre 2001-2003.
[4] L’interdiction du mariage de la musulmane avec le non-musulman : une forme d’exclusion, Amel Grami, 2001-2003. Le mariage de la musulmane avec un non musulman : dépassement ou transgression des frontières, Asma Nouira, 2008.